Le président Diomaye et le premier ministre Sonko appellent au « dialogue politique » le 28 mai prochain. Parmi les plus de 300 partis politiques enregistrés dans le pays, les partis et coalitions néocoloniaux libéraux et sociaux libéraux appellent à boycotter pendant que les autres partis saisissent l’opportunité d’y participer.
Les Assises Nationales, initiative de salubrité publique à l'époque pour stopper la dérive autocratique monarchiste de la première alternance libérale, avaient préconisé la réduction du pouvoir présidentiel né du coup d'État franco-senghorien contre le président du Conseil, Mamadou Dia, en 1962. Le tandem présidentiel et primatorial actuel a annoncé vouloir réduire le pouvoir présidentiel et accroître celui de la primature.
Les termes de références publiés du « dialogue politique » centrent principalement ses axes sur le code, l’administration et les institutions pour améliorer l’organisation et assurer la transparence des élections.
Mais n’est-il pas aussi nécessaire d’opérer à un examen en profondeur du régime présidentiel néocolonial qui a été jalonné par le coup d’état franco-senghorien de 1962, le massacre de 1963, le multipartisme limité du milieu des années 70, le multipartisme intégral de 1981, les vols électoraux de 1988, puis 1993, la première alternance libérale de 2000, la révolte populaire du 23 juin 2011, la seconde alternance libérale de 2012, les tueries de 2021 à 2024 et de tirer les leçons de la victoire finalement obtenue par la résistance populaire souverainiste de 2024 ?
Ne devons-nous pas répondre à la question cruciale de savoir ce qui est plus avantageux au projet de « rupture et de transformation systémique » contre le néocolonialisme : le régime présidentiel ou le régime parlementaire adossé à la démocratie participative populaire avec droit de révocation au peuple ?
L’histoire politique en Afrique et singulièrement de notre Sunugal montre que le régime présidentiel a accompagné la mise en place du système de domination néocoloniale qui a remplacé, à l’exception de l’Algérie et de la Guinée du PDG/RDA, le système politique colonial en mettant à la tête de nos États dits indépendants les représentants politiques de la bourgeoisie et des féodaux compradores ayant abdiqué devant l’impérialisme.
La petite bourgeoisie intellectuelle et technocratique s’est ainsi muée en bourgeoisie bureaucratique d’État intermédiaire entre les Multinationales coloniales et les classes laborieuses de notre peuple à la place des « nègres traitants » de l’économie coloniale. Sur le plan économique, ce remplacement va produire un système d’enrichissement illicite qui va engendrer un système de lutte politique pour les portefeuilles ministériels.
Devenir ministre ou DG des multiples agences parapubliques est en effet le chemin le plus court et le plus rapide pour devenir millionnaire sous Senghor, centaine de fois millionnaire sous Abdou Diouf, puis milliardaire sous Abdoulaye Wade et dizaine voire centaine de fois milliardaire sous Macky Sall.
Le lien dialectique entre économie et politique dans des colonies devenues néo-colonies est ici facteur de démultiplication des partis politiques légaux, chacun d’eux ayant des « gourous » à la quête de postes ministériels et de concurrence pour le fauteuil présidentiel. Il suffit de se remémorer ces honteuses rivalités entre leaders de partis politiques, notamment de gauche, qui a permis au bourgeois A. Wade de se moquer des leaders et partis de l'ex-gauche en disant qu'ils "jouaient aux communistes... pour les subsides de Moscou".
Même si tous les régimes peuvent être utilisés par l’oppression impérialiste, il apparaît néanmoins que le présidentialisme est le régime qui correspond le mieux aux racines féodales non extirpées par la forme coloniale et néocoloniale du capitalisme importé par la conquête impérialiste de nos pays.
Voilà pourquoi, les dictatures civiles et militaires néocoloniales qui se sont succédé en Afrique ont quasiment toutes adoptées le régime présidentiel pour combiner à la tête de nos États dits indépendants la servilité aux intérêts impérialistes par le biais de la corruption et l’endettement endémique et l’enrichissement illicite par le vol des deniers publics.
Les régimes politiques ne sont en réalité que la superstructure étatique qui coiffe l’économie réelle et les rapports réels d’exploitation et d’oppression entre les classes sociales d’un pays donné. Qu’ils soient monarchiste, monarcho-parlementaire, présidentiel ou parlementaire, les régimes politiques sont les formes par lesquelles une classe ou une alliance de classes sociales exerce sa domination sur une société, un peuple, une nation.
Mais les classes laborieuses, le peuple, les démocrates, les souverainistes ne peuvent être indifférents à la forme prise par l'État, instrument de la classe ou de la coalition des classes au pouvoir.
Au Sénégal tout comme dans les pays de l’AES (Mali, Burkina, Niger), les peuples se sont soulevés pour renverser les pouvoirs libéraux néocoloniaux. La lutte contre la domination impérialiste prend la forme d’une confrontation entre les camps politiques souverainistes et néo-coloniaux dans la longue marche vers la souveraineté nationale et la sortie de nos pays du sous-développement imposé.
Même si les conditions et formes nationales différent entre le Sénégal et l’AES confrontée plus ouvertement aux questions sécuritaires terroristes et séparatistes, il est fondamental de faire en sorte que le peuple souverain soit la force qui par son intervention garantisse la marche vers la souveraineté nationale. Du Sénégal à l'AES, notre classe politique se divise ainsi entre ceux qui luttent pour la souveraineté nationale et ceux qui maintiennent le néocolonialisme.
Voilà pourquoi, il est indispensable que soit posée et examinée la question du régime parlementaire adossé à la démocratie participative populaire avec droit de révocation.
Dans les cas des pays frères de l’AES, ce sont les mobilisations populaires contre les démocratures bourgeoises corrompues civiles et militaro-civiles néocoloniales impotentes face aux guerres Otano-djihado-terroristes qui ont été parachevées par les interventions des fractions souverainistes des armées nationales.
Dans le cas du Sénégal, il est clair que c’est l’intervention du peuple contre l’État libéral néocolonial hors la loi de l’APR/BBY qui a été décisive pour obtenir les victoires électorales présidentielle de mars et des législatives de novembre 2024.
Il s’agit maintenant de refonder les Etats en adoptant des institutions qui favorisent le plus possible l’engagement du peuple dans les affaires nationales. C’est dans cette optique qu’il faut rompre avec le présidentialisme pour le régime parlementaire adossé à la démocratie participative qui dote le peuple du pouvoir de révocation immédiate de tout élu.
Cette proposition, non retenue à l’époque, avait déjà été formulée lors des Assises Nationales de la diaspora par l’auteur qui la repose aujourd'hui.
17/05/25
Diagne Fodé Roland
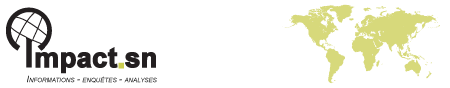
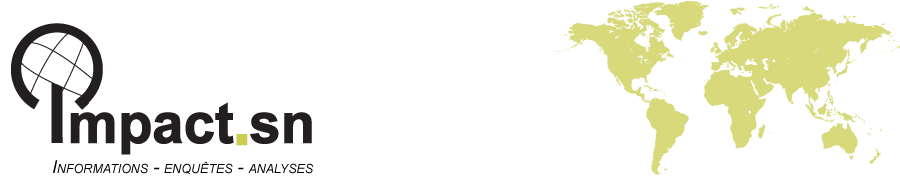
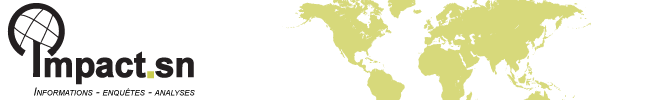






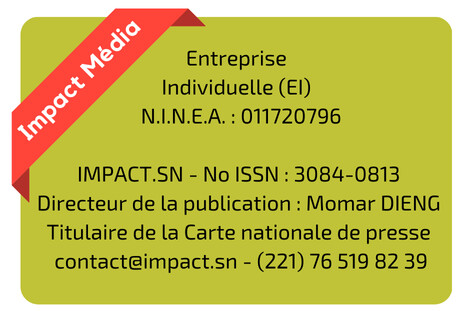





 FRANCE
FRANCE















