
Le mardi 28 mai 2024, le Sénégal organisera la quatrième édition de la Journée du Dialogue national, centrée cette année sur le thème « La réforme et la modernisation de la Justice ». Annoncé par le Chef de l’État lors de son allocution du 3 avril, « cet événement représente une occasion d'examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire sénégalais, d'identifier les dispositions légales et réglementaires à améliorer et de concevoir une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions proposées » ; dixit le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
Cette initiative, conformément aux termes de référence élaborés à son effet, a pour objectif de restaurer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Elle rassemblera les professionnels du secteur, tels que les magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, ainsi que les professeurs d'université et les citoyens.
Comme mentionné dans un précédent article (https://www.dakaractu.com/Contribution-Pour- un-dialogue-authentique-au-nom-de-notre-pays_a142207.html ), que pour réussir un dialogue à portée nationale sur des sujets ayant un impact significatif sur la vie de la nation et garantir son succès, sept (7) critères doivent être réunis.
Parmi ces critères figurent, entre autres, la bonne foi des parties prenantes et leur disponibilité au changement, tout en tenant compte des intérêts variés, surtout dans une thématique multi- acteur ; le choix judicieux des participants, qui doivent être de véritables acteurs maîtrisant la thématique pour que les débats n’aillent pas dans tous les sens.
Il est aussi des conditions, l’existence d’un facilitateur impartial, pouvant être une personnalité respectée qui pourra conduire les débats et arbitrer en cas de divergence. Le dialogue doit s'inscrire dans la durée et ne pas se limiter à un simple exercice de séduction en période de crise. Il est essentiel de communiquer de manière transparente les résultats du dialogue à tous les acteurs et de prendre en considération leurs réactions.
Enfin, un mécanisme de suivi doit être mis en place pour garantir l'application des engagements et décisions issus du dialogue, sans quoi l'exercice perdrait de son utilité. Toutes ces conditions semblent être respectées, et la nomination d'une personnalité telle que le professeur émérite de droit constitutionnel, le Professeur Babacar Gueye, est un gage de succès pour cet événement.
Au vu des thématiques proposées : le statut des magistrats, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, la dématérialisation du service public de la justice, le régime de la sanction pénale, les réformes de l’administration pénitentiaire et les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi..., il est heureux de noter que tous ces sujets ont été abordés et largement discutés par des acteurs du secteur, à travers des publications, les conclusions et recommandations de séminaires et ateliers, ainsi que des programmes et projets du ministère de la Justice soutenus par les partenaires au développement.
Dans le nombre de ces publications figurent, "la modernisation de la justice au Sénégal : vers la recherche de la performance" de l’inspecteur général de la Justice, le magistrat Cheikh Tidiane Lam ; "la réforme de l'organisation judiciaire du Sénégal" du magistrat et ancien SGG adjoint, Papa Assane Touré, les productions du Professeur Moussa Samb sur "l’accès des justiciables à la justice" et sur "la justice de proximité "; "le Procureur de la République" de l’Avocat Général pré la Cour d’appel de Dakar , le magistrat Youssouf Diallo, qui aborde le fonctionnement des parquets d'instance assorti de propositions pour un meilleur fonctionnement du service public de la justice et d’autres publications sur la réforme et la modernisation du secteur judiciaire.
Aussi faudrait-il prendre en compte les nombreux programmes et projets de réformes du secteur judiciaire relatifs à l’indépendance des juges, à l’efficacité de la justice au service de tous les citoyens portés par le ministère lui-même ; à l’image du programme « justice judiciaire » soutenu par les partenaires techniques et financiers du Sénégal, ainsi que les propositions de réforme faites par les organisations de la société civile, et qui sont nombreuses et bien élaborées. Toute chose qui offre de la matière dans une réforme judiciaire à la hauteur des attentes des acteurs et des populations.
Cependant, des aspects essentiels du besoin de réforme judiciaire ne sont pas pris en compte par les différentes productions disponibles, malgré leur importance capitale pour la communauté musulmane sénégalaise qui a un besoin spécifique en matière de législation et dont l’intégration pourrait inaugurer une nouvelle ère de laïcité positive et inclusive pour notre État comme jadis théorisé par le Président Dia dans lettres d’un vieux militant.
La Cour Cadiale : une réforme consolidante
Faisant partie des demandes fortes des organisations religieuses musulmanes, il faut reconnaître que les tribunaux musulmans existaient déjà pendant la période coloniale et faisaient partie intégrante du système judiciaire du pays, aux côtés des structures du droit civil français. Le colonisateur les avait acceptés non pas par convenance, mais en reconnaissance de la réalité que la population sénégalaise était largement musulmane et se référait au droit musulman de rite malikite dans la gestion de ses affaires familiales et communautaires. Les cours cadiales étaient dirigées par des juges musulmans appelés cadis, dont l'avis était recueilli en matière de droit familial, notamment dans le domaine du divorce et de la succession.
La marginalisation de ces juridictions n'a engendré qu'une méfiance, voire une hostilité, d'une part importante de la communauté musulmane envers le système judiciaire moderne. En raison de cette marginalisation, de nombreux citoyens musulmans préfèrent des arrangements et des procédures de conciliation internes plutôt que de recourir à la justice officielle.
L'efficacité du système judiciaire ne dépend pas seulement de sa dimension coercitive, mais aussi de la confiance et de la valeur que lui accordent ceux qui en font usage. La restauration de ces tribunaux contribuerait grandement à rétablir la confiance entre la justice et les justiciables, notamment à travers une justice de proximité et de médiation. Ce qui diffère de l’actuel statut du cadi, sans voix délibérative dans les tribunaux d’instance, alors qu’à l'époque coloniale leurs décisions avaient force exécutoire.
Le Code du statut personnel musulman : une demande de réforme légitime
Un autre problème de légitimité des réformes judiciaires réside dans l'insuffisante prise en compte du droit musulman sur les questions familiales ; ce qui crée d’énormes difficultés au règlement des conflits d’ordre familiale et contribue à l’engorgement de nos tribunaux. Ainsi, un code du statut personnel musulman permettrait de corriger les dysfonctionnements et les lacunes du code de la famille de 1972, dont l'adoption a été controversée et l'application a largement contribué à la désarticulation des relations familiales au Sénégal.
Ce malaise persistant a suscité une réflexion approfondie sur ce code tout au long des années 80. Des thèses ont été rédigées pour en identifier les manquements et mesurer son impact négatif sur nos rapports sociaux et familiaux.
En collaboration avec le Collectif des associations islamiques et les familles religieuses, une instance de réflexion dénommée CIRCOFS (Comité islamique pour la réforme du code de la famille au Sénégal) a été mise en place, et celle-ci a eu à rédiger un avant-projet de code présenté lors d’une conférence tenue le 12 octobre 2002 à Dakar, ayant réuni 29 délégués des grands foyers religieux du pays, notamment Seriñ Abdoul Aziz Sy junior RA, représentant Tivaouane, Seriñ Mourtada Mbacké RA, signataire pour Touba, Seriñ Sidy Moctar Kounta RA, représentant Ndiassane et du représentant de la communauté layène, Seriñ Moussa Guèye Laye RA. Ensuite, un « Comité de suivi en charge des démarches jusqu’à l’adoption du projet de code de statut personnel » a été mis en place et une demande d’audience envoyée au chef de l’État de l’époque, maître Abdoulaye Wade, signée entre autres par Thierno Mountaga Tall, Seriñ Abdoul Aziz Sy junior, au nom du khalife général des tidjanes, Seriñ Mourtada Mbacké, au nom de Seriñ Saliou Mbacké, et par le Khalife général de Ndiassane.
Il a été malheureux de constater que cette demande a été rejetée par le président de l’époque, pensant qu’il s’agissait d’un projet d’islamisation de la société sénégalaise. Idée saugrenue, car la société sénégalaise était déjà musulmane et islamisée à 95%. Le recul a permis de savoir, qu’il s’agissait d’une manipulation d’ ̋extrémistes laïcards ̋ qui ont donné au chef de l’Etat la mauvaise explication sur la portée de cette réforme, lui qui, depuis l’étranger d’où il s’exprimait, parlait de main et de tête à couper.
Bien que ce code ait déjà été déposé sur la table du Président de l'Assemblée nationale, il semble malheureusement être resté dans l'ombre, sans être examiné.
En définitive, ...
Pour toutes ces considérations, et au vu de la condition d’inclusion du dialogue qui rapprochera davantage les justiciables sénégalais de leur justice, les acteurs de la société civile musulmane, ont l’obligation de prendre part à ce dialogue pour porter leur voix et contribuer à la naissance d’une nouvelle justice avec des réformes hautement consolidantes, faisant de chaque Sénégalais un citoyen à part entière dans son propre pays.
Ismaila NDIAYE
Analyste en Gouvernance et Anticorruption
Secrétaire Général
Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS)
Coordination des Associations et Mouvements Islamiques du Sénégal (CAMIS)
Membre Union des Ulémas d’Afrique
imams.senegal@gmail.com
ismandiaye777@yahoo.fr
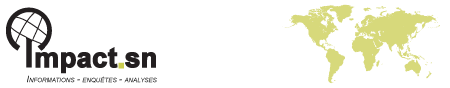
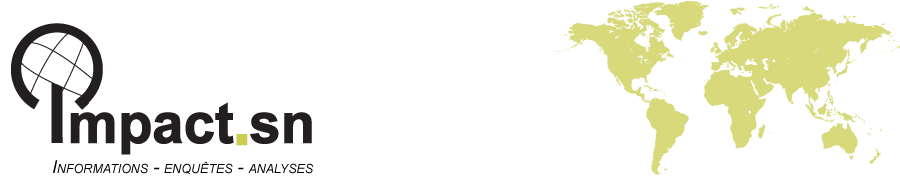
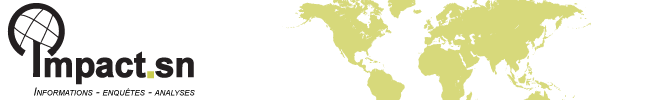





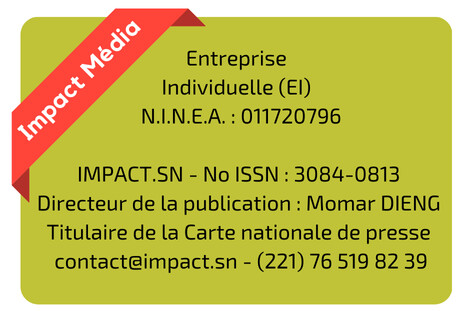





 FRANCE
FRANCE















