
Dans l’ambiance d’une révolution citoyenne victorieuse au Sénégal, il faut s’imaginer ce qu’a été pour notre délégation insoumise ce temps, hors du commun. Sur place : la dynamique, l’enthousiasme, l’intervention citoyenne à tout propos. La joie ! Mais par connexion, le contraste avec l’ambiance pourrie de la France raciste et néocoloniale mobilisée dans les violences, les haines, les insultes et les menaces sur les Insoumis. La France…. et son écœurante caste officielle entièrement mobilisée pour l’invisibilisation du génocide des Palestiniens de Gaza. Quelle tristesse !
Mais l’action permet de dépasser la démoralisation nauséeuse répandue par la France. Oui, heureusement l’action politique permet de garder espoir. Pour nous, depuis là-bas, c’était le suivi des meetings et des émissions de télé de la méthodique campagne européenne menée par Manon Aubry, l’action des milliers de groupes d’action insoumis et leurs porte-à-porte géants, la campagne de Younous Omarjee en Guyane et aux Antilles. Et bien sûr les échanges avec le groupe parlementaire que mène Mathilde Panot, à l’œuvre sur les dossiers brulants Nouvelle-Calédonie, fin de vie et loi de programmation agricole. Et chaque jour des manifs et rassemblements pour la fin du massacre à Rafah.
Le Sénégal d’Ousmane Sonko, c’est une révolution citoyenne victorieuse. Elle a commencé dans l’ambiance d’une insurrection contre un pouvoir décidé à s’octroyer la possibilité d’un troisième mandat présidentiel. Pour cela, il n’hésita pas à agresser physiquement le peuple, emprisonner les chefs de l’opposition, tuer des manifestants, reporter les élections. En vain. Il s’effondra sous la pression de l’action du peuple, jamais relâchée. Il eut tout juste le temps de reconvoquer une élection présidentielle en dix jours ! Et elle fut gagnée dès le premier tour par le parti de l’insoumission sénégalaise : le Pastef d’Ousmane Sonko. Un parti dont le président était sous le coup de procédures judiciaires absurdes et diffamatoires, ainsi qu’une bonne partie de la direction du mouvement. Domestication de la justice et diffamation intense étaient devenues le quotidien de l’opposition dans les registres habituels des campagnes médiatiques contre les nôtres dans le monde entier : accusations d’antisémitisme, d’extrémisme islamique et, bien sûr, de terrorisme.
Comme partout ailleurs, la « goche », d’abord alliée au Pastef, a rompu l’alliance au nom du « style » (« le problème c’est Sonko »). Elle a servi de tireur dans le dos en maintenant des candidats et en laissant dire les pires calomnies contre le Pastef. Pour finir, l’ancien maire de Dakar, candidat, a fait un score du type de son amie la maire de Paris : moins de deux pour cent. Toutes les nuances, « sensibilités » et autres pacotilles mondaines furent balayées. Pour se faire une idée, disons que cette ambiance de décomposition c’est celle qu’encourage l’entité politique « Libération » en France à chaque élection. Face à cela, Ousmane Sonko a maintenu contre vents et marées la « ligne de rupture ». Cette ligne, c’était celle du programme du Pastef. Elle est sur le fond et sur la forme très largement similaire à « l’Avenir en commun ».
Ce n’est pas un phénomène isolé, cette révolution citoyenne sénégalaise ! Au contraire, elle est regardée avec passion par tous les peuples et nations africains. Le mouvement, commencé en Amérique latine pour répliquer aux politiques néolibérales qui avaient dévasté les sociétés du sous-continent américain, continué dans le Maghreb, avait déjà produit des effets au cours de la décennie dans l’Afrique subsaharienne comme au Soudan, au Burkina et au Mali par exemple. Mais ici, pour la première fois, l’insurrection débouche sur une victoire électorale et un programme complet. C’est pourquoi ceux qui ne veulent pas voir tout finir dans une impasse et une répression de type tunisienne ou soudanaise, ou bien dans les coups d’État type Mali, Burkina, etc. se tournent, pleins d’espoir, du côté de la méthode démocratique Sonko et son Pastef. Ce mouvement politique continental va s’approfondir en même temps que se creusent les conditions qui le provoquent.
Le nombre des humains est le moteur de l’histoire. L’Europe vieillissante n’a pas idée de la dynamique qui soulève le continent africain, où aura lieu une naissance sur deux d’ici 2050. Dans le Sénégal actuel, 50 % de la population a moins de 19 ans et 70 % a moins de trente ans… L’adage dit : « Chaque génération est un peuple nouveau ». Connecté, urbanisé, alphabétisé, le « nouveau peuple africain » entre sur la scène de son histoire. La poussée démographique africaine achève de mettre en tension un système aux abois. Car le système est incapable d’inclure la nouvelle génération dans un quelconque projet d’avenir.
Cette impuissance est le résultat d’un désastre organisé de longue main par les néolibéraux. À la fin du vingtième siècle, dans les années quatre-vingt, l’Afrique a servi de cahier de brouillon aux politiques dites « d’ajustement structurel ». Elles furent ensuite appliquées avec le même aveuglement féroce à la terre entière, dévastant nations et peuples. La logique à l’œuvre est bien connue : moins d’État et plus de marché. Formule se réduisant vite à plus simple : le marché remplace les services publics. Donc, pour cela, il faut détruire l’État et les services publics. À l’époque, là où l’État était naissant, là où les services publics commençaient seulement, le désastre fut complet. Du peu qu’il y avait, il ne resta rien. Et rien ne remplaça ce qui était détruit.
Non seulement les PIB reculèrent, mais les différences entre pauvres s’accrurent. L’Asie pauvre, plus alphabétisée, moins démunie d’écoles, de routes, de voies ferrées et d’hôpitaux, résista. Et elle se releva. L’Afrique néocoloniale s’enfonça. Utilisée comme atelier du monde, l’Asie développa son activité en direction du marché mondial et s’inséra dans la division internationale du travail de l’ère de la mondialisation. L’Afrique, tournée encore largement vers son marché intérieur, accepta pourtant de s’ouvrir aux marchandises mondialisées. Elle se fit donc écraser et, pour finir, elle fut même remplacée sur son marché intérieur. C’est à ce désastre organisé que répondent les soubresauts politiques africains qui accompagnent le déploiement du nouveau siècle.
Notre étude de la révolution citoyenne sénégalaise confirme point par point les thèses de « la théorie de l’ère du peuple et de la révolution citoyenne ». Dans les échanges, nos interlocuteurs le découvrirent avec une joyeuse surprise. Et nous aussi, autant le dire. Les phases de l’action (instituante, destituante), les outils de celle-ci (réseaux et boucles de messageries), rythmes et phases, transcroissance des revendications, tout y est comme dans plus de vingt cas étudiés dans mon livre « Faites mieux ». La même remarque vaut pour les formes et moyens d’action déployés par le parti-mouvement, le Pastef, lui-même par comparaison avec le mouvement insoumis (le vrai, pas celui que raconte la classe médiatique sur la base de ragots).
Portées par une écrasante majorité de jeunes femmes et hommes, ces méthodes sont quasiment sans rapport avec le fonctionnement des partis traditionnels, notamment ceux de gauche. Gazeux, auto-organisé, il inclut d’amples zones floues où s’effacent les limites du mouvement et celles des structures de l’auto-organisation populaire. L’osmose dans l’action, ici, se combine avec la symbiose des organes de l’action concrète. Réseaux sociaux et méta-réseaux (un réseau de réseaux) forment la vraie trame de coordination au fil de l’action, chaque jour plus dense. Et cela jusqu’au détail. Au Sénégal aussi, chacun se faisait un devoir de « ne pas attendre les consignes ».
Un plan d’action se mijote entre Pastef et France insoumise. Notre choix n’est pas d’être des « partis frères » style années soixante, mais des partenaires attelés à des « causes communes ». Il s’agit de construire une mobilisation des opinions sur des sujets délimités. Nous ne sommes pas identiques, parce que nos sociétés ne le sont pas. Nous partons de cette évidence pour éviter de la nier au prix d’abstractions qui finissent toujours mal. « Mal », cela veut dire dans la confusion, les malentendus et les bavardages. C’est d’un ensemble volontairement limité d’actions concrètes dont nous partirons donc. J’en réserve le récit au moment où les deux organisations en auront convenu noir sur blanc.
La délégation insoumise était entièrement « fonctionnelle ». Cela veut dire que ses membres avaient tous une raison d’être là pour leur tâche. C’étaient Manuel Bompard (Bouches-du-Rhône) coordinateur du mouvement insoumis, Nadège Abomangoli (Seine-Saint-Denis), membre du bureau de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Arnaud Le Gall (Val-d’Oise), coordinateur international de LFI, Aurélien Taché (Val-d’Oise), rapporteur sur la francophonie à l’Assemblée nationale. L’agenda était dense. Nous étions répartis sur des tâches et rencontres diverses, publiques ou non. Une rencontre au sommet des deux organisations politiques a eu lieu dès le premier jour, regroupant une centaine de hauts cadres du Pastef, en présence d’Ousmane Sonko et du nouveau secrétaire général du parti Sinon, nous n’étions regroupés que pour les conférences dont le prononcé me revenait.
La conférence à l’université publique de Dakar a été organisée à l’initiative d’Ousmane Sonko en tant que président du Pastef. C’était sa première expression publique depuis son élection. Son discours a donc fonctionné sur le mode d’une déclaration de politique générale. L’ambiance survoltée dans la salle s’explique par ce contexte. Pour ma part, j’en suis resté à la démonstration « théorique » initialement prévue. Car, dès lors que le Premier ministre s’exprimait en général, en incluant la relation avec la France, il va de soi que je ne pouvais pas être celui qui pouvait « répondre » sur les sujets qu’il soulèverait. L’ambiance dans la salle et autour d’elle était extrêmement ardente, engagée mais aussi bienveillante à notre égard. En nous situant comme « l’autre voix de la France », Ousmane Sonko a désamorcé les confusions de rôle qui auraient pu paralyser la rencontre.
Quand on est entrés dans l’énoncé de nos divergences, l’exercice a été très sain car il a inauguré une autre façon d’avoir des relations internationales, non seulement moins formelles, mais plus ouvertes. Personne n’a plus besoin de faire semblant. Je ne m’attendais pas à l’évocation du sujet de la polygamie et des droits LGBT. La vidéo de ma réponse a beaucoup tourné. En France, et aussi au Sénégal. Je n’y ajoute rien. Il est clair qu’une majorité très nette de la salle ne partageait pas mon point de vue. Cependant j’ai eu le sentiment, en regardant les visages, que la réflexion avait aussi son chemin. Mais je veux témoigner du fait qu’il n’y eut jamais la moindre agressivité à ressentir. J’ai été formidablement accueilli et raccompagné dans la même ambiance amicale par les étudiants comme par Ousmane Sonko, enchantés de l’échange. Rien à voir avec la France et son ambiance de méchanceté, quand des commandos violents de type « Nous vivrons » ou de l’Union des étudiants juifs de France cherchent à pourrir l’ambiance des salles dans les facs.
À l’école supérieure de commerce, l’ambiance était évidemment dans le ton et le style d’une conférence académique, et de ce point de vue je m’y trouvais plus à l’aise, car j’en revenais à la présentation de mon livre. Je pense mettre en forme le texte de ce prononcé pour en faire une brochure sur mon blog. En tous cas, ce fut aussi le moment d’une certaine solennité. Il y avait des étudiants de huit pays d’Afrique et divers patrons de multinationales. Peu banal, des ambassadeurs avaient tenu à être présents : Afrique du sud, Algérie, Arabie saoudite, Égypte, Maroc, Palestine, RDC, Tunisie. Lamentable, la France des interdictions et du sectarisme n’avait pas trouvé le temps d’accompagner une délégation de cinq de ses parlementaires. Il y a dix ans, un tel sectarisme ne s’imaginait pas. Au contraire. Si, affectivement, cela me déçoit, il n’en reste pas moins qu’aux yeux des autres pays, ce n’est pas moi, ni les insoumis, qui sommes diminués par cette situation."
Jean Luc Mélenchon
(*) Le titre est de la rédaction de impact.sn
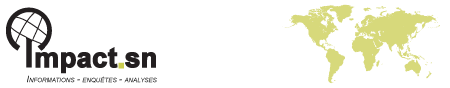
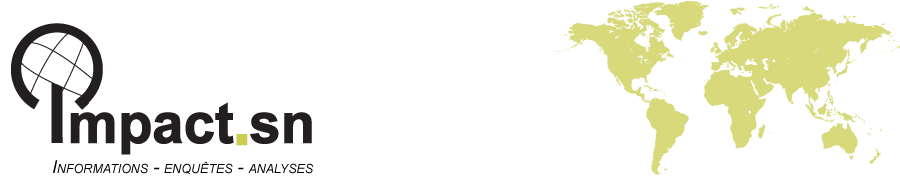
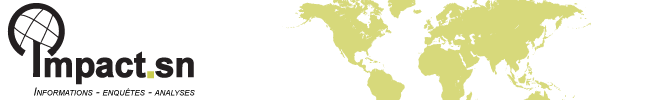





 PRÉSIDENTIELLE 2024
PRÉSIDENTIELLE 2024





 FRANCE
FRANCE









